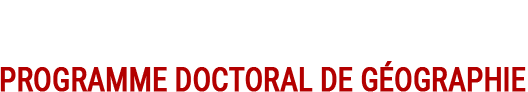Information détaillée concernant le cours
| Titre | Policy mobilities: circulations et traductions des modèles, notions et méthodes en sciences sociales |
| Dates | 07 mai 2021 |
| Responsable de l'activité | Raphaël LANGUILLON |
| Organisateur(s)/trice(s) | Mme Cécilia Raziano, UNIGE M. Raphaël Languillon, UNIGE |
| Intervenant-e-s | Elisabeth Peyroux, géographe chargée de recherche au CNRS et directrice-adjointe de l'UMR Prodig Hervé Munz, anthopologue chercheur à l'Université de Genève |
| Description | Depuis le tournant des années 2010, on observe dans les sciences humaines et sociales un accroissement du nombre de travaux francophones et anglophones traitant de l'accélération de la circulation internationale des modèles, des politiques et des représentations. Le terme circulation fait toutefois l'objet de débats, occultant de nombreuses réalités comme l'adaptation et l'hybridation aux contextes locaux, les relèves générationnelles dans la vie des idées et l'évolution des pratiques, les dispositifs matériels accompagnant la mobilité de l'information ou encore les modalités de la mutation des phénomènes immatériels imputable à leur mise en mouvement. Pour répondre à ces enjeux, le monde académique a vu émerger le champ des policy mobilities, qui s'est structuré sur les questions suivantes : comment les politiques, les modèles, les bonnes pratiques… sont-elles rendues mobiles ? Par qui et quels canaux ? Avec quelles ressources ? Selon quelles modalités ? Dans quelles mesures et pourquoi la mobilité des politiques et des idées conduit-elle à les transformer ? Comment sont-elles alors convoquées, mobilisées, traduites, adaptées d'un contexte à l'autre ? Enfin, le monde académique est lui aussi consommateur et producteur d'idée qu'il transforme : comment s'opère le processus d'appropriation et de digestion académique des notions, modèles, politiques, idées que les chercheurs et les chercheuses emploient et (re)travaillent ?
Cette activité CUSO s'articule autour de deux parties : l'une théorique en matinée, l'autre réflexive et méthodologique dans l'après-midi.
Au cours de la session matinale, nous introduirons dans un premier temps le concept de policy mobilities (ses définitions, son évolution, les différentes disciplines des sciences sociales qui le mobilisent, ses méthodes, les débats qu'il suscite). Nous discuterons ensuite trois présentations de travaux, articles, chapitres d'ouvrage ou compte-rendus de recherche mobilisant le concept, chacun provenant de différentes disciplines des sciences sociales (géographie, urban studies, sciences politiques, relations internationales, sociologie, démographie,...). Ces discussions seront menées par un·e modérateur·rice selon trois modalités différentes : 1) présentation d'une recherche achevée ou en cours ; 2) retour réflexif et critique sur un enjeu ou une méthodologie rencontrés par un.e chercheur.euse ayant trait aux policy mobilities ; 3) lecture commentée d'un texte académique écrit ou non par le ou la discutant.e. Les participant·e·s, qui préalablement auront lu et préparé les articles ou les textes des présentations, interviendront tout au long de la matinée lors des nombreuses séances de discussion.
La session de l'après-midi portera sur la circulation et la traduction des modèles (policy), notions, méthodologies depuis et à travers le milieu académique, étant transposés et transposables de la catégorie savante vers la catégorie de la pratique, et vice-versa. Cette partie de la journée se concentrera autour de réflexions quant aux pratiques de chercheur·euses dans lesquelles la question des policy mobilities s'est posée (ou se pose). Celles-ci peuvent se construire autour de différents enjeux : méthodologiques, éthiques, déontologiques, théoriques, notionnels, disciplinaires, épistémologiques... Les intervenant·e·s (pris parmi les participant.e.s) présenteront pendant 10-15 minutes ces enjeux qui seront suivis d'une discussion collective. La dernière heure de la journée sera consacrée à la mise en place d'une synthèse transversale du concept de policy mobilities et de ses différentes traductions.
|
| Programme |
Travail préalable à l'atelier :
- Une capsule de cadrage épistémologique sur les policy mobilities (~20 minutes) - Une capsule de témoignage personnel méthodologique et pratique (~20 minutes) - Deux textes proposés par les deux intervenant.e.s
Programme :
Matinée (10h-12h30) - Mot de bienvenue - Tour de table des participants - Cadrage épistémologique (en rappel à la capsule vidéo) - Présentation d'Elisabeth Peyroux + retour du/de la discutant.e + questions/réponses des participant.e.s - Pause - Présentation d'Hervé Munz + retour du/de la discutant.e + questions/réponses des participant.e.s
Après-midi (13h30-16h00) - Bref retour sur les présentations du matin par les participant.e.s et les discutant.e.s - Rappel de la capsule vidéo témoignage - Réactions/discussions - Pause - Témoignages des participant.e.s et discussion collective - Conclusion/synthèse par un témoin
- Echanges conclusifs |
| Lieu |
A distance |
| Information | |
| Places | 17 |
| Délai d'inscription | 02.05.2021 |